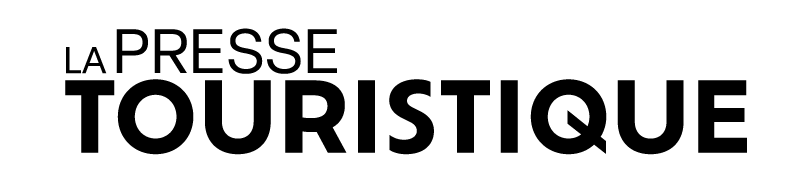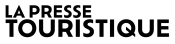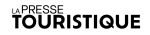Un peu d’histoire
Le dindon sauvage avait été identifié pour devenir l’emblème aviaire des États-Unis, car il était commun à tout l’est de l’Amérique du Nord tout en étant une source de nourriture accessible pour le peuple. Finalement, le dindon sauvage a presque disparu au début du 20e siècle et le pygargue à tête blanche est devenu l’oiseau emblématique pour nos voisins du sud. Aujourd’hui, les populations sont abondantes, mais notre relation avec cet oiseau est relativement récente.
En effet, c’est autour des années 1976 que des premiers dindons ont été vus et la première nidification confirmée date d’une quarantaine d’années. Depuis 2001, un programme d’introduction et de relocalisation de l’oiseau, organisé par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, a porté fruit si bien que cette espèce est stable et même abondante dans certaines régions plus agricoles de la province.
Tout un oiseau
Le premier aspect qui impressionne chez le dindon, c’est sa taille – surtout quand il s’agit d’un mâle adulte, que l’on surnomme un Tom. Quand il parade pour séduire les femelles, il gonfle littéralement tout son plumage et ses mouvements ressemblent à une chorégraphie. Dans les faits, un gros mâle pourra peser 28 lbs et il fera environ 125 cm en hauteur.
Le dindon sauvage est un oiseau très adaptatif, mais il préfère les habitats boisés de forêts mixtes entrecoupés d’ouvertures et de champs. Il se nourrit d’herbes, de petits fruits, de bourgeons, d’herbacés, de petits insectes, et ils affectionnent abondamment ce que nous semons. Cependant, comme il est très opportuniste, il est possible d’observer des dindons manger des petits rongeurs ainsi que des salamandres.
Tous les dindons dorment aux arbres durant la nuit afin d’échapper aux nombreux prédateurs comme les renards et les coyotes. Puis, face à un danger, un dindon pourra même courir un peu plus de 20 km à l’heure.
La femelle dindon ne fait pas de nids aux arbres si bien qu’elle pond ses œufs au sol sur un couvert de feuillages. La femelle sera d’un immobilisme parfait durant la période de couvaison qui dure environ une trentaine de jours et elle donnera naissance à entre 8 et 16 dindonneaux. J’ai déjà observé une femelle avec 17 petits dans Lanaudière et une autre avec 18 dindonneaux dans les Laurentides.
Comment le chasser
Ce qui m’intéresse particulièrement à la chasse aux dindons sauvages, c’est qu’il s’agit d’un oiseau bavard qui peut se laisser berner vocalement si on le provoque auditivement. Malgré le fait qu’il soit très vocal, plusieurs attributs font en sorte que cette chasse demeure un défi. Il a notamment une excellente ouïe qui lui permet d’entendre de faibles sons à une longue distance. Le chasseur se doit donc d’être très discret.
Un autre point fort du dindon est son excellente vision. Selon plusieurs études, le dindon aurait une vision en couleur et son champ de vision s’étend jusqu’à 300 degrés. Comme il n’a pratiquement aucun odorat, il se sert surtout de sa vision pour trouver sa nourriture. Le chasseur doit se vêtir de camouflage tout en restant immobile afin de ne pas se faire remarquer.
Pour convaincre le dindon de venir jusqu’à lui à portée de tir, le chasseur doit apprendre son vocabulaire afin d’imiter ses vocalises avec justesse. Il existe des centaines d’appeaux différents servant à imiter le dindon. Sinon, on peut retrouver au Québec plusieurs vidéos et tutoriels pour apprendre cet art. Il est aussi recommandé d’utiliser des appelants comme leurres visuels. Les appelants les plus efficaces sont souvent ceux imitant un mâle juvénile afin de créer une forme de compétition. Un leurre visuel imitant une femelle provoquera aussi tout un effe.
Info-dindon!
Pour chasser le dindon sauvage, les intéressés doivent compléter une formation en ligne offerte par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Il est permis de chasser trois dindons sauvages par année au Québec, soit deux au printemps vers la fin avril (mâle seulement) et un dans certaines zones en automne. Chaque dindon prélevé doit être enregistré notamment pour faire des suivis sur l’état des populations.